Relier les existants, avec Philippe Descola
Par Jacques Vauloup le mardi 16 mars 2021, 03:42 - Anthroposcènes - Lien permanent
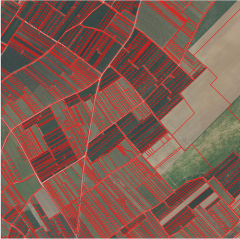 Saurons-nous habiter la Terre ? À une condition, d'après l'anthropologue Philippe Descola : penser le monde sans distinguer la culture de la nature. C'est ce qu'il propose dans son maître ouvrage Par-delà nature et culture (2005). Il appelle à une recomposition et à un réaménagement des sciences humaines.
Saurons-nous habiter la Terre ? À une condition, d'après l'anthropologue Philippe Descola : penser le monde sans distinguer la culture de la nature. C'est ce qu'il propose dans son maître ouvrage Par-delà nature et culture (2005). Il appelle à une recomposition et à un réaménagement des sciences humaines.
En même temps que les Modernes découvraient la paresseuse propension des peuples barbares et sauvages à tout juger selon leurs propres normes, ils escamotaient leur propre ethnocentrisme derrière une démarche rationnelle de connaissance dont les errements devenaient dès lors imperceptibles
(page 10).
L'anthropologue américaniste Philippe Descola, élève de Claude Lévi-Strauss, a forgé ses analyses tout particulièrement sur une enquête de terrain en Amazonie chez les Jivaros Achuar. Il en a tiré la conviction que l'opposition entre la nature et la culture ne possède pas l'universalité qu'on lui prête, car elle est dépourvue de sens pour tous autres que nous, les Modernes ; et qu'elle est apparue tardivement au cours de la pensée occidentale elle-même
(page 13).
Relier les existants
Déf. Pour Descola, le terme global les existants
relie ce que les humains rationalistes ont (récemment) séparé en trois ordres d'espèces vivantes : animaux, végétaux, humains.
Afin de mieux nommer les continuités et discontinuités entre l'homme et l'environnement, et d'arrêter de faire du second au mieux un simple entourage, au pire un esclave assujetti à l'ordre humain
, l'anthropologue propose quatre nouvelles manières de regrouper les existants
à partir de traits communs qui se répondent d'un continent à l'autre :
Le totémisme. Il développe une continuité matérielle entre humains et non humains.
L'analogisme. Il tisse un réseau de discontinuités entre les éléments du monde, structuré par des correspondances.
L'animisme. Il prête aux non humains l'intériorité des humains, mais les en différencie par le corps.
Le naturalisme. Il nous rattache aux non humains par les contraintes ou continuités matérielles et nous en sépare par l'aptitude culturelle.
Est-il possible encore possible/plausible de ranger parmi les universaux une opposition entre la nature et la culture dont l'antiquité ne remonte guère au-delà d'un siècle ?
D'après Philippe Descola, bien des sociétés primitives n'ont jamais songé que les frontières de l'humanité s'arrêtaient aux portes de l'espèce humaine, elles qui n'hésitent pas à inviter dans le concert de leur vie sociale les plus modestes plantes, les plus insignifiants des animaux
. Il invite l'anthropologie et, plus largement, les sciences humaines, à repenser leur domaine et leurs outils. Et à fonder un nouvel humanisme incluant dans leur objet bien plus que l'anthropos : l'ensemble de la collectivité des existants
.
Pour aller plus loin
Descola P., Une écologie des relations, CNRS éditions, 64 p.
Anthropologie de la nature, leçon inaugurale de Philippe Descola au Collège de France
Être présent au monde, Philippe Descola sur France Culture, La Grande Table, 22 février 2021