Jeunes ruraux : scolarités bridées, petits boulots, grandes galères
Par Jacques Vauloup le mardi 4 mars 2025, 04:59 - S'orienter - Devenir - Lien permanent
 Depuis les années 2000, le nombre de jeunes sortant de formation initiale sans diplôme ou avec uniquement le diplôme national du brevet (DNB) a baissé de 11 % à 7 %. Toutefois, galère, précarité et pauvreté n'ont pas disparu, notamment en milieu rural. Deux études éclairent cette fragilité spécifique de la jeunesse rurale.
Depuis les années 2000, le nombre de jeunes sortant de formation initiale sans diplôme ou avec uniquement le diplôme national du brevet (DNB) a baissé de 11 % à 7 %. Toutefois, galère, précarité et pauvreté n'ont pas disparu, notamment en milieu rural. Deux études éclairent cette fragilité spécifique de la jeunesse rurale.
Dans Bref du Cereq (février 2025), Petits boulots et grandes galères, être jeune sans diplôme en milieu rural, Clément Reversé rend compte d'une enquête qualitative ethnographique auprès d'une centaine de jeunes de Nouvelle-Aquitaine (Charente, Creuse, Gironde). L'essentiel : dans le milieu rural observé, les jeunes non-qualifiés construisent leur rapport au travail avec de faibles opportunités et une précarité constante.
Attachement à des emplois peu valorisés mais localement accessibles, rejet des dispositifs d’aide sociale, souvent perçus comme stigmatisants. Il faut travailler pour exister et être reconnu socialement. Contrats précaires, petits boulots, missions d'intérim, emplois temporaires ou saisonniers enchaînés les uns après les autres... Insistons encore : contrairement à une opinion commune, ces jeunes veulent travailler, car le travail est le marqueur du passage à la vie adulte et à la reconnaissance sociale.
« C’est des jeunes qui n’ont pas grand-chose et les recruteurs le savent. S’ils sont prêts à faire certaines concessions, en termes de flexibilité, de rémunération et tout, ils peuvent travailler… Après, est-ce qu’on va leur proposer un contrat à durée indéterminée (CDI) ? C’est autre chose », explique un conseiller en Mission Locale. Fragilité, dépendance, instabilité, marginalité sont structurelles.
Ce qui importe pour les employeurs, c'est qu’ils soient « disponibles » pour répondre à des besoins ponctuels et épars : «Quand je peux, je travaille un peu dans les vignes. C’est au black, mais au moins ça permet de travailler parce que sinon ça serait compliqué. » (Samantha, 19 ans, sans activité). Qu'ils travaillent en usine, dans l’agriculture ou dans le tertiaire, les jeunes rencontrent une relation dégradée
au marché du travail.
Pour ces jeunes, même précaire, le travail est une question d'honneur, de passage à l'âge adulte et d'indépendance. Tout sauf l'assistanat !
Ou alors, de manière temporaire : « J’ai pris le RSA (Revenu de solidarité active) pendant trois mois, mais c’était parce que je pouvais plus rien payer. Après, dès que j’ai trouvé un boulot, j’ai tout arrêté. Je veux pas qu’on me prenne pour un assisté », explique Tiago, 26 ans, intérimaire. Pour mémoire : le RSA est ouvert, sous condition de ressources, aux personnes âgées d'au moins 25 ans révolus.
Ainsi, contrairement au discours chafouin anti-jeunes ambiant, pour ces jeunes ruraux sans diplôme, le travail, même sous des formes précaires et dévalorisées, reste un pilier symbolique et social qui permet de revendiquer une place légitime dans la société.
Et l'assistanat est massivement rejeté par eux. Les politiques publiques d'aide sociale sont-elles adaptées aux jeunes de 18-24 ans ? Sont-elles adaptées aux jeunes ruraux ?
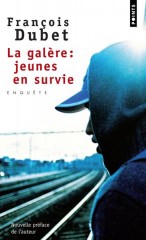
Une jeunesse rurale délaissée, invisibilisée
Dans un rapport de novembre 2024, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) focalise son attention sur les « invisibles », les jeunes ruraux (environ 1 jeune sur 4). Partir ou rester ? Un choix crucial pour eux, certes, mais tout autant pour l’avenir des territoires ruraux. L'IGAS qualifie les conditions de vie des jeunes ruraux, leur sentiment de délaissement, et examine les réponses qui leur sont apportées. Une enquête sur la tranche d'âge des 16 - 29 ans, de l'âge de la fin de l'obligation scolaire à celui de l'âge du premier enfant.
Huit territoires ruraux étudiés, des rencontres avec 350 interlocuteurs, un questionnaire adressé aux jeunes suivis par les Missions locales... Bref, du solide ! Le rapport dessine le portrait d’une jeunesse rurale qui se sent souvent délaissée et de jeunes ruraux précaires ou vulnérables, plus difficiles à atteindre, davantage invisibles. La mission estime à environ 338 000 le nombre des jeunes ruraux de 18 à 24 ans vivant sous le seuil de pauvreté (entre 800 et 1200 euros par mois pour une personne seule, selon les critères définis).
Les jeunes ruraux partagent des traits communs à l'ensemble de la jeunesse : difficultés d’accès à l’emploi des « débutants » sur le marché du travail, taux de chômage élevé (22,4 % en moyenne, jusqu'à 40% parfois), poids de l’emploi précaire (37,8 % des jeunes ruraux en emploi sont en CDD ou intérim) ; difficultés d’accès au logement. Comme les jeunes des quartiers urbains défavorisés, les jeunes ruraux issus en grande majorité de milieu populaire, faiblement diplômés, se trouvent placés face au dilemme : « quitter mon territoire ou trouver un emploi pour y rester ».
Le rapport insiste sur le sentiment de manque
ressenti : moindre présence des services publics et des équipements, temps de déplacements accrus et distances supplémentaires, éloignement des lieux de travail, mobilité empêchée, sentiment d'isolement, autocensure du fait de moindres opportunités de formation et d'insertion (28 % des jeunes ruraux accèdent à l’enseignement supérieur, contre 37 % des jeunes urbains), non recours aux droits élevé en raison du coût de la mobilité et de la quasi-absence de transports publics.
Jeunes ruraux : améliorer au plus vite les réponses publiques
Le rapport stigmatise l'inadaptation des dispositifs sociaux et sanitaires (problème spécifique de la santé mentale des jeunes) en faveur des jeunes ruraux précaires : comment ouvrir le champ des possibles et lutter contre l’autocensure ? Comment toucher des jeunes, peu nombreux, disséminés dans des territoires très dispersés, au-delà des bourgs ruraux et des petites villes ?
La mission dresse le constat que les prestations sociales auxquelles peuvent accéder les jeunes ruraux précaires prennent mal en compte les difficultés auxquelles ils font face : enchevêtrement des dispositifs, durée limitée de l’allocation Contrat d'engagement jeunes (CEJ) qui rend difficile l’accès à un logement, coût élevé de la mobilité pour les jeunes ruraux.
L'IGAS formule 26 recommandations. La plus importante : prioriser les jeunes les plus vulnérables en milieu rural, souvent éloignés des centres urbains. Tout découle de cette ultra-priorité : travail, formation, mobilité, santé, logement, etc. Des mesures non seulement socialement équitables et indispensables pour éviter la désespérance des jeunes, mais nécessaires à des territoires fragilisés.
On aime le professionnalisme, le volontarisme et... l'optimisme des rédactrices du rapport quand elles donnent rendez-vous aux gouvernants chargés de la mise en place de l'action publique préconisée dès 2026 (élections municipales) ou 2027 (élection présidentielle, élections législatives)... au plus tard ! Se demande-t-on pourquoi les jeunes ruraux soit ne votent pas, soit votent pour des partis illibéraux ? ●■

Pour approfondir